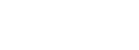Mode des jetees-Promenades en mer du Nord au XIXe
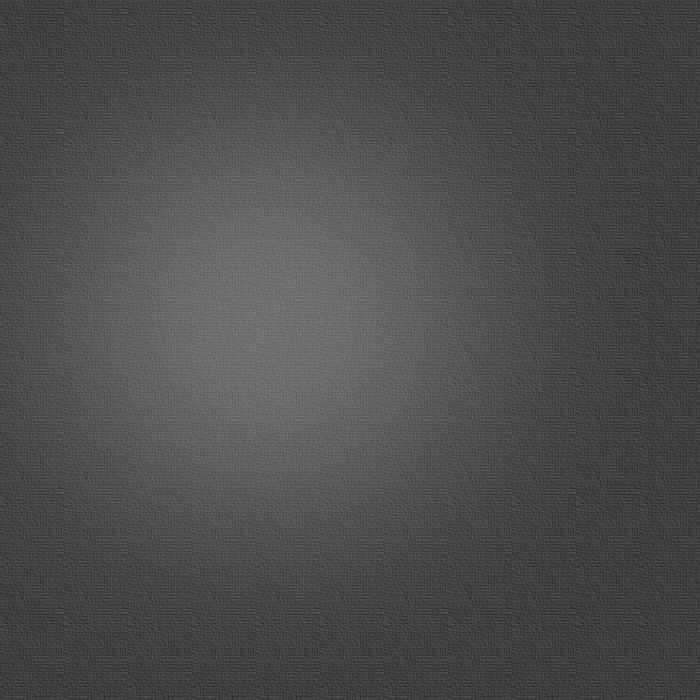
Un pont lancé sur la mer : la jetée promenade par Emmanuelle Gallo
«La jetée promenade se différencie des jetées d’entrée ou autres digues portuaires, en ce sens qu’elle ne protège ou ne marque aucun chenal de port1. Elle se lance directement vers la mer à partir du rivage créant ainsi une typologie urbaine particulière tout en développant différentes fonctionnalités, ludiques comme utilitaires. Même si formellement les jetées promenades s’apparentent aux ponts, elles ne s’accrochent que d’un côté à la terre pour se jeter dans le vide de l’autre. Si on peut évoquer la liaison entre deux mondes, il s’agit d’une jonction éphémère, via un navire. Cette situation particulière a des conséquences sur l’équilibre de la structure et s’accompagne de difficultés spécifiques lors de la construction sur la surface de l’estran.
On remarquera par ailleurs que la jetée promenade n’est pas vraiment une manifestation du génie français. En effet, les jetées qui se sont développées sur les côtes françaises sont issues du modèle anglais des « piers ». Ainsi, la première jetée britannique a été édifiée en 1813- 1814 à Ryde dans l’île de Wight : la Ryde Pier 2.»
Voir suite de l’article ci-dessous.
Diaporama des Jetees-promenades fin XIXe en tirages d’époque colorisés
9 décembre 2013
Suite de l’extrait:
«Ce nouvel équipement permet de favoriser le cabotage à toute heure, c’est-à-dire quand certains ports et leurs chenaux d’accès sont asséchés lors de la marée basse. Ce type de circulation des biens et des personnes est particulièrement important avant l’arrivée du chemin de fer et après le bateau à vapeur (à aubes dans un premier temps). La construction de nouvelles jetées ne tarde pas : Brighton Chain Pier (1822-1823), Margate Pier (1824), Walton-on-Naze Pier (1830), puis Herne Bay Pier (1831) par l’ingénieur Thomas Telford (1757-1834). Le phénomène des jetées promenades se développe sur les côtes britanniques tout au long du XIXe siècle; quatre-vingt-cinq en tout. Les créations s’échelonnent diversement : cinq jetées pendant les années cinquante, dix-neuf pendant les années soixante, vingt pendant les années soixante-dix, onze pendant les années quatre-vingt, quatorze pendant les années quatre-vingt-dix, neuf entre les années 1900 à 1910. Une partie de ces jetées promenades ont été détruites (le plus fréquemment par des tempêtes, des incendies et des collisions avec des navires), parfois elles ont été remplacées par de plus récentes.
Après 1860, le caractère monofonctionnel du cabotage s’estompe, la jetée devient un espace plus complexe5. Cette nouvelle construction du premier âge touristique (1850-1930) peut être assimilé à un jardin de plaisir, autre invention anglaise datant du milieu du XVIIIe siècle6. Ainsi, la ville balnéaire se donne en spectacle : l’objectif est de transformer un site linéaire, la baie, la plage, en un ensemble de panorama complexes. À l’extrémité de la jetée, on peut s’imaginer être en train de découvrir la côte par bateau, sans aucun mal de mer. Dans une recherche de plaisir et de confort, les jetées promenades s’équipent : dans un premier temps, on y construit des abris où l’on prend des rafraîchissements. Puis, les activités commerciales et ludiques se complexifient : on y trouve des kiosques à musique, des restaurants, des casinos, des salles de bal, des salles de concert et plus tard, de cinéma. Les espaces requis peuvent devenir considérables, surtout au regard de ceux nécessaires à la première fonction : permettre des appontements. Ces nouveaux développements correspondent à l’expansion du chemin de fer qui favorise le tourisme et la croissance des cités balnéaires. Il existe alors une véritable émulation entre les villes côtières qui veulent édifier la plus longue, la plus sophistiquée des jetées promenades, susceptible d’attirer le plus de visiteurs. L’apogée du phénomène se situe pendant les années 1880-1890, qui se prolonge pendant les premières années du XXe siècle. Il est fréquent que les jetées les plus anciennes et les plus simples formellement, soient élargies et complétées d’un pavillon à l’extrémité, parfois à l’occasion d’une réfection suite à un dommage. Dans quelques cas, plusieurs jetées ponctuent la même station balnéaire : deux comme à Yarmouth, Morecambe, Hastings, Weston-Super-Mare, Colwyn-Bay, Brighton, trois comme Blackpool (North, Central, South). Notons que l’apogée des jetées Anglaises coïncide avec la banalisation de la marine à vapeur, dont la propulsion se fait majoritairement grâce aux hélices, après 1870.
C’est lors de la phase d’expansion des jetées promenades anglaises que le modèle franchit la Manche avec les jetées de Blankenberghe (1895) et d’Ostende pour la Belgique et de Scheveningen (1904) pour les Pays-Bas. En France, les jetées se développent également à Trouville (1870-1890), à Nice (1880-1891) et sur le bassin d’Arcachon : la jetée d’Eyrac (Arcachon, 1845), le débarcadère à Bélisaire (Cap-Ferret, 1876), la jetée de la Chapelle (Arcachon, 1899), la jetée Thiers (Arcachon, 1903), le débarcadère Piquey (Piquey, 1928), la jetée du Canon (Le Canon, 1932). Notons, qu’il a eu également de 1890 à 1893 des projets, finalement avortés, de jetée promenade à Villers-sur-Mer, non loin de Trouville.
Dans un premier temps, observons l’édification de la jetée de Nice. Le Marquis d’Espouy de Saint Paul fait émerger l’idée, approuvée ensuite par le Conseil Municipal du 20 novembre 1875. « Les touristes pourraient, après avoir acquitté un droit d’entrée, se promener au-dessus de la mer ». Le marquis obtient une concession du domaine maritime d’une aire de 6 500 m2, le 31 mars 1879. Les travaux commencent dès 1880, jusqu’au 4 avril 1893, où un incendie détruit l’ensemble, alors presque achevé. Le 20 décembre 1888, la « société anonyme de la nouvelle jetée de Nice », structure franco-belge, est constituée et reprend le projet ainsi que les travaux. La première étape consiste en une surélévation de la plateforme de 1,75 mètres. La construction repose sur 250 pilotis de fonte creuse, vissés à une profondeur de 5 mètres dans le sol (diamètre enterré de 0,9 mètre). La profondeur de l’eau varie suivant la position des piliers par rapport à la plage de 2 à 10,40 mètres. Les pilotis sont reliés en partie supérieure par des poutres en treillis et des croix de Saint-André au- dessous. Des voûtes minces de béton de Grenoble (7 centimètres d’épaisseur) constituent le plancher établi sur le treillis (surface : 100 x 130 mètres). L’imposante superstructure réalisée par l’entreprise parisienne Moisant repose sur cet ensemble, dont le montage s’achève en février 1890. Des éléments de briques creuses légères assurent le remplissage et le support des nombreuses décorations. L’ensemble du bâtiment développe une surface de 6 500 m2, surmonté d’une coupole de 25 mètres de haut. La liaison avec la rive est assurée par un pont de 60 mètres de long sur 13 mètres de large.
Cette jetée promenade niçoise illustre parfaitement les fonctions commerciales et ludiques du modèle. En effet, la Méditerranée ayant des marées de peu d’ampleur, il n’y a pas de nécessité d’aborder le long de cette jetée, le port pouvant accueillir des navires à toute heure. Il s’agit d’un équipement exceptionnel d’une grande station de villégiature hivernale.
Dans le cas d’Arcachon, il semble que ce soit exactement l’opposé. Le terme de débarcadère utilisé à plusieurs reprises indique clairement la fonction de ces constructions. Leurs abondances (au moins six) sur une partie restreinte du littoral renforce l’hypothèse de cette nécessité, due sans doute autant aux contraintes liées aux marées, qu’à la pente sous-marine de la côte. Notons que l’une des jetées a été reconstruite après-guerre (1946), ce qui marque une utilité matérielle ou symbolique suffisante.
À Trouville, l’aventure commence lorsque l’hôtel des Roches Noires, construit par Alphonse Nicolas Crépinet (1827-1892)19 en 1864 à l’extrémité nord-est de la plage, est revendu en 1869 à la société anglaise The Trouville Association Limited. Les commanditaires d’origine, messieurs Jacques Louis Adolphe Cordier (1817- 18**) et Paul Louis Target (1821-1908), des juristes, élus du mouvement Orléaniste, rencontrent alors des difficultés financières répétées. Le 1er août 1870, les nouveaux propriétaires proposent une conférence sur une digue de bois de 850 mètres de long de la côte ; puis les années suivantes, font l’acquisition à cette fin de terrains au nord-est de l’hôtel. En 1877, une digue sera édifiée partiellement en pierre sèche à cet endroit, mais une tempête la détruira. Au printemps 1880, la presse, par la voix de La plage de Trouville, fait état d’un nouveau projet : « Le bruit répandu et qui accrédite de plus en plus, c'est que les propriétaires des Roches Noires, vont, à l'instar de ce qui existe déjà de l'autre côté du détroit, à Brighton, ville de bains du Comté de Sussex (Angleterre), établir une digue, qui partant du pieds de la falaise, s'avancera jusqu'à 600 mètres dans la mer, avec voie carrossable et à l'extrémité de laquelle sera édifié un casino rectangulaire, entièrement fait de fer et de verre. Voyez ici l'effet que pourra produire sur nos jolies baigneuses une valse entraînante, lorsqu'un orchestre Pasdeloup viendra mêler ses sons les plus mélodieux aux murmures des flots ». La presse attribue le projet à M. Harding, cependant les documents administratifs font état d'un autre demandeur : M. Bellingham présenté comme secrétaire délégué de la Société de la Compagnie Anglaise du tunnel sous la Manche, ce qui lui confère un prestige certain et démontre les rapports privilégiés entre les deux pays, sur le plan des affaires et des audaces technologiques. Le Maire de Trouville d’alors, M. Lemazurier, appuie la demande même si il a quelques inquiétudes sur les mouvements de sable de la plage. Il entrevoit la croissance d'attraction que pourrait développer la station balnéaire ainsi équipée ; et il souligne les relations privilégiées que cet équipement pourrait permettre avec le Havre comme avec les îles Britanniques.
Le projet de jetée promenade s’accompagne en fait de la création d’un nouveau quartier derrière la digue sur laquelle s’appuiera la jetée. Parallèlement aux annonces à la presse, des autorisations administratives sont demandées en 1881. À l’automne de la même année, les travaux se succèdent d’une marée basse à l’autre. Cependant, deux années plus tard, ils seront toujours en cours, retardés par des difficultés techniques, comme les trois mois d’arrêt hivernaux. Les ingénieurs se succèdent : en mars 1883, l’anglais Wittins remplace le français Deshoulières. Une commission d'enquête préalablement nommée se réunie, présidée par le nouveau maire M. Durand-Couyère ; à cette occasion les ingénieurs Boreux et Picard des Ponts et Chaussées du Calvados approuve le projet : « Cette jetée aura 550 mètres de long sur 10 mètres de large à l'extrémité une plateforme de 60 mètres de long sur 40 mètres de large permettra de construire un restaurant, de distance en distance des kiosques élégants et confortables contenant des bibliothèques, permettant aux promeneurs de se reposer et de respirer l'air salin de la mer à plein poumon. De plus, à l'extrémité de cette jeté à marée basse, il y aura encore 3 mètres d'eau de sorte que les bateaux pourront arriver à Trouville à toute heure ». L’année suivante, la demande est soumise au Conseil d’État et un décret du 10février1883, accorde à la Société des Immeubles de Trouville, représentée par de MM. Bellingham et Oliffe l’autorisation d’établir et d’exploiter une jetée promenade à l’est du port de Trouville.
Toutefois, il se passera encore quelques années avant que la digue sur laquelle s’accroche la jetée soit achevée en 1888. Alors, cet été-là, le projet passe au stade du chantier : le 1er juillet, les machines, le matériel et les hommes sont arrivés. Le 5 août, les « piliers fermes » de la jetée ont été débarqués sur les quais. Parallèlement, la construction d’une digue de 300 mètres (d’une surface de 11 805 m2) est officiellement autorisée suite à un rapport favorable de l'ingénieur ordinaire Masson du service des ponts et chaussées du Calvados. La jetée promenade a été construite en trois étapes, en deux belles saisons pour la partie linéaire d’une longueur de 350 mètres et une troisième pour la partie de l’embarcadère de 45,30 mètres par 24,40 mètres. La largeur standard estde 9,45 mètres avec trois élargissements à 15,55 mètres qui sont situés à 95,02 mètres, 190,52 mètres et 316,92 mètres mesurés à partir de la digue. La structure est composée d'une succession de travées de 15 mètres d'ouverture, interrompue parfois par des travées d'escaliers plus courtes. Les travées se divisent en trois arches de fer parallèles réticulées reposant sur des piles de fer cruxiformes. Celles-ci sont battues directement dans la couche d'argile qui se trouve au- dessous du sable. Les piles sont situées en retrait par rapport au tablier et il y a donc un porte- à-faux de part et d'autre. Les arches et leurs contreventements en croix de Saint-André sont réalisés en acier doux. Les rambardes de protection sont, en fait, des bancs qui courent tout le long de la jetée. Les arches supportent des poutrelles espacées de 0,30 mètres parallèlement à la côte, « le tillac de la jetée est formé d’un plancher en madriers en cinq centimètres d’épaisseur distants de 0,01 » posé perpendiculairement à la côte.
Cettenouvelle construction a été conçue par Alexander B. W. Kennedy (1847-1928), ingénieur anglais, conseil de la société de construction Darlington Wagon and engineering Compagny de Darlington, pour la Société de M. Harding The Trouville Pier and Steamboat Compagny. Cet ingénieur issu de la School of Mines de Jermyn Street a exercé ses talents dans différentes directions. Comme constructeur, il a réalisé, outre la jetée de Trouville, un hôtel et un théâtre. Spécialiste des machines à vapeur, dont celles qui propulsent les bateaux, il ouvre en 1874 un nouvel enseignement par l'expérimentation à University College et à partir de 1890, se consacre presque exclusivement à l'électricité et ses applications. Membre dès 1879 de The Institution of Civil Engineers, il gravit les échelons qui le mène en 1906 à la présidence de cette prestigieuse institution et, en 1905, à l'anoblissement. C'est sans doute ses relations avec le milieu des machines à vapeur qui l'amène à être consulté pour la jetée de Trouville dont le financement semble lié aux bateaux à vapeurs.
L’été 1888, les travaux avancent rapidement : les travées sont enfoncées dans le sol à marée basse. Pendant la marée haute, les ouvriers « n'étaient pas inoccupés, ils montaient et rivaient leurs cintres, qui maintenant sont prêts à être posés et le seront incessamment ». Le chantier fait l’objet d’une curiosité générale, des visiteurs « chaque jour se rendent sur les travaux pour assister à la pose de ces immenses pièces de charpente de fer ayant une longueur de 17 mètres environ et pesant de 2 à 3 000 kilos ». « La charpente en fer de cette jetée ne présente pour ainsi dire pas de surface non plus de résistance à la mer en mouvement. Le travail a donc été calculé pour faire solide et résistant quoique léger pour l’œil, (...) Les fers arrivent d’Angleterre tout ouvrés, troués, prêts à être boulonnés sur place, fabriqués par la Compagnie Darlington Wagon and Engineering Limited. (...) Les piles sont formées de trois pilotis en fer creux à cornière, très épais, placé sur la même ligne, entrecroisés à leur sommet ainsi qu’en deux autres points de la hauteur totale, c’est-à-dire au sommet, dans le milieu et dans le bas, ce qui relie ces pilotis au point de former un tout rigide d’une seule pièce. Chaque pilotis est couronné d’un large chapiteau boulonné avec lui, c’est sur ce chapiteau que vient reposer un arceau cintré ; autant d’arceaux cintrés que de pilotis, donc trois cintres par arches. (...) Ces pilotis composés de quatre pièces boulonnées à leur extrémité inférieure, sont taillés en biseau comme certains porte-plumes. Au moyen d’une haute chèvre armée d’un pesant mouton de 1500 kilogrammes, chèvre placée d’abord sur le sable, puis portée plus tard par un grand chaland à flot, lorsque les travaux se sont avancés au loin dans la mer, ces pilotis ont été enfoncés d’abord dans le sable, jusqu’à la rencontre d’une table calcaire horizontale de 60 centimètres de puissances, qu’ils ont assez facilement traversée pour pénétrer au-dessous dans une glaise compacte d’un gris foncé presque pétrifiée ». En novembre, cinq travées de 15 mètres soit 75 mètres de jetée se lancent vers le large. Cet état de fait est d’ailleurs constaté légalement par l’ingénieur des ponts et chaussées. L’année suivante, en 1889, les tempêtes de février interrompent le battage des pieux, mais pas le montage des éléments. En mars, « on s'installe pour chasser des pieux en bois, qui sont des arbres 6 à 7 mètres de longueur pour former un échafaudage au-dessus du niveau de la mer basse, afin d'y placer la sonnette et pouvoir travailler chaque jour à l'enfoncement des pieux en fer, on ne pourrait le faire que 4 à 5 jours seulement à marée basse. Une nouvelle machine à vapeur d'une grande force va remplacer l'ancienne trop faible et une sonnette, nouveau système remplacera aussi celle qui a servi jusqu'alors ». La dernière partie de la jetée, plus large, termine l’ensemble avec des embarcadères de part et d’autre et un restaurant au centre. L’embarcadère est composé d’une trame rectangulaire de six éléments par quatre de 7,55 mètres de long par 6,10 mètres de large. L’estacade est réalisée par une structure de bois qui double vers l’extérieur la structure métallique afin d’absorber l’impact des navires. Cette structure s’équilibre de part et d’autre en passant au travers l’autre structure de métal. « La jetée est pourvue sur ses faces de deux escaliers séparés par un intervalle de 100 mètres ; à chaque escalier correspond un organeau pour l’amarrage des petits bateaux. Des engins e sauvetage sont disposés de distance en distance en cas d’accidents». Un éclairage nocturne est prévu afin de signaler la jetée aux embarcations: il «se compose uniquement de deux lanternes à feux blancs placées verticalement à trois mètres l’une de l’autre, le feu inférieur se trouvant à 5 mètres au-dessus du niveau des plus hautes mers » ; l’ensemble situé à l’extrémité de la jetée. Ces « appareils dioptriques de 0 m 20 de diamètre » fonctionnent à l’huile minérale. Les frais afférant à cet éclairage, matériel et personnel, revient aux concessionnaires de la jetée.
En mai 1890, la jetée promenade terminée est inaugurée à la pentecôte : « Un orchestre Viennois joue sur la jetée tous les jours dans la matinée et l'après-midi. Des tentes ont été installées pour protéger du vent et du soleil ». Toutefois, si les visiteurs sont les bienvenus, les accostages ne sont pas encore autorisés. Le décret du 9 mars 1889 substitue M. G. P. Harding aux droits et obligations de MM. Bellingham et Oliffe pour la construction et l’exploitation de la jetée, correspondant à un investissement de 60.000 actions d’une Livre, soit 1,5 million de francs. En 1891, la société des Ateliers Schwartz-Haumont à Haumont (Nord) a été chargée de l'entretien de la jetée promenade comme l’indiquent certains des tirages de plans bleus, disponibles au archives de la Cité de l’architecture. En 1892, l’accostage est rendu possible par des essais avec un steamer rapide, puis par une autorisation du vice- amiral Lespès. Sur les six aller-retour journaliers des vapeurs, quatre sont effectués à partir de la jetée ; tous les jours, l'arrivée se fait à 9 heures, le départ à 10 heures, puis nouvelle arrivée à 5 heures et départ à 6 heures. La semaine des courses 60.000 personnes ont fait la traversée. En 1893, la jetée est éclairée au gaz, comme l'est également le chemin des planches. La même année, le café restaurant installé sur la plate- forme est terminé et chaque bateau transporte entre 500 et 600 personnes, pendant la saison car la liaison s'interrompt de novembre à mars. En 1897, les horaires des chemins de fer et les traversées par bateaux seront coordonnés grâce à la jetée, alors que celle-ci subit de gros dégâts après une tempête. Cet été là, au mois d’août, des concerts sont donnés tous les jours sur l’extrémité de la jetée moyennant un droit d’entrée. En 1901, après plusieurs années de négociation, une liaison directe avec Brighton est établie grâce au vapeur Brigthon Queen, 300 personnes peuvent alors faire l'aller retour pour 12,50 francs. En 1900, le nombre de voyageurs entre le Havre et Trouville passant par la jetée atteint 248 115. En 1902, la jetée est considérée par le ministère des travaux publiques comme une extension du port. En 1905 et après nombres de péripéties juridiques, les concessions de la digue et de la jetée sont mises en vente publique et la Société Normande de Navigation en fait l’acquisition pour 300.000 francs, confirmé par un décret. La même année, le restaurant est repris par l’ancien chef d’ambassade Dougnac. En 1917, un incendie ravage le restaurant situé sur l’embarcadère, dégâts évalués par l’architecte Trouvillais Maurice Vincent, chargé alors de l'entretien de la jetée. En 1920, un bar est construit en remplacement du restaurant à l’extrémité de la jetée. En 1926 et 1927, la partie débarcadère est remise en état sous la direction de Maurice Vincent, les parties métalliques étant réalisées par les Ateliers Schwartz- Haumont.
Pendant l’Occupation, la plage et ses différents équipements sont dévastés. La jetée promenade est dans un premier temps, dès août 1940, réquisitionnée par l’armée Allemande. L’année suivante, le bureau du directeur, puis le restaurant « José » situés sur la digue, sont également réquisitionnés, le dernier ayant été rasé. L’année suivante, en 1942, l’accès à la jetée promenade est interdit et donc son entretien devient impossible. Endommagée par plusieurs tempêtes, la jetée est finalement démolie du 30 juin au 13 octobre 1943 afin de ne pas favoriser un débarquement allié. La verrière de l’hôtel des Roches Noires, sera de même démolie simultanément. Il ne semble pas qu’il ait été question de projet de reconstruction dans le cas de la jetée promenade de Trouville après-guerre. La route et la voiture représentent alors la nouvelle modernité, avec le pont de Tancarville et le bac du Hode qui facilitent l’accès au Havre. La jetée et sa liaison maritime sont moins utiles, d’autant que les voitures ne peuvent pas traverser. Toutefois, fin 1949, l’architecte trouvillais Maurice Vincent a été chargé d’évaluer le montant des dommages (jetée et constructions annexes), soit 5.827 .500 francs avant la déduction de la vétusté69. On constate qu’il y a eu reconstruction de la jetée à Arcachon. De même, aux Pays-Bas, la jetée de Scheveringen a été reconstruite « en grand » dans une logique de loisirs. Dans les deux cas, le matériau de structure choisi est alors le béton.
Après cette brève visite dans le monde des jetées promenades voyons en quoi ces « ponts » sont différents des autres. Comme les constructions ne peuvent s’appuyer que d’un côté, la structure doit donc être hyperstatique, il n’y a pas de symétrie, ni d’arcs bloqués contre les rives. Contrairement aux piles de pont traditionnellement en maçonneries larges et massives, les piles des jetées sont fines et en métal. Même si les ponts et les barrages présentent quelques risques, les structures des jetées promenades sont beaucoup plus exposées aux dangers des éléments naturels (marées, tempêtes et esquifs à la dérive) ainsi qu’à la corrosion.
Dans le cas des jetées promenades comme dans celui des ponts, on réunit bien des espaces différents, mais de manière discontinue. Cela permet également le transfert de marchandises d’une côte à une autre, par bateaux à toute heure, en liaison avec d’autres moyens de transport comme les chemins de fer. Cependant, et surtout sur le continent, les jetées demeurent un phénomène éphémère, contrairement aux ponts qui se situent plus dans la pérennité. Sur le plan urbain, la jetée peut être envisagée comme une première extension sur l’eau, ainsi qu’on peut le voir aujourd’hui couramment à Monte-Carlo. On peut remarquer que si les fonctions ludiques et commerciales de la jetée semblent nouvelles, les ponts accueillaient autrefois des activités artisanales et commerciales le long des voies centrales. Aujourd’hui, les activités ludiques, commerciales et touristiques peuvent encore être centrées autour d’un pont : c’est le cas du pont du Gard, malgré les protections patrimoniales. De même, le Viaduc de Millau, comme création contemporaine, devient une véritable attraction en soi.
Au Royaume-Uni, la remise en état de jetées reste toujours d’actualité. On pourrait souhaiter que ce genre de projets concerne également les côtes françaises. Quelques travaux de fin d’études d’architecture des dernières décennies proposent des jetées comme réaménagement urbain du front de mer à Malo-Les Bains, Ouistreham et Nice.